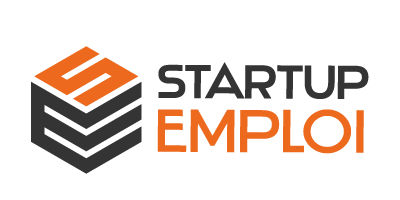60 heures, trois ans. Une équation qui en dit long sur la façon dont la formation des AESH a été repensée depuis 2019. Finie l’intensité condensée sur une année, place à un accompagnement étiré, mais qui ne masque pas la réalité : ces professionnels, pourtant indispensables à la vie des écoles, démarrent leur parcours avec un salaire inférieur au SMIC, alors même que les besoins explosent partout dans les établissements scolaires.
La titularisation ? Elle demeure l’exception, pas la règle. Les possibilités de se former, elles, s’élargissent lentement, trop lentement pour répondre à la demande. Les passerelles vers d’autres métiers de l’éducation ou du médico-social existent, certes, mais rares sont celles et ceux qui les franchissent.
Le rôle essentiel des AESH dans l’inclusion scolaire
Sur le terrain, AESH rime avec inclusion. Leur présence transforme l’ordinaire des élèves en situation de handicap : un coup de pouce discret par ici, une adaptation nécessaire par là, parfois un mot rassurant quand tout semble basculer. Leur mission, loin de se cantonner à l’organisation pure, consiste à rendre l’espace de la classe vivable, compréhensible, accessible. Ce sont eux qui tissent la confiance entre enseignants, familles et enfants, veillant à ce que personne ne soit laissé de côté.
Chaque élève porte une histoire différente, des besoins uniques. En ULIS, la capacité d’improviser et de faire preuve d’initiative devient vite indispensable. Les AESH construisent les projets de scolarisation sur mesure, modifient les supports, apaisent les angoisses devant la complexité scolaire.
Les élèves en situation de handicap avancent grâce à une relation de confiance, construite jour après jour avec leur AESH.
En alliance avec les enseignants, les accompagnants éducatifs et sociaux contribuent à bâtir une école plus juste, capable de s’ajuster à la singularité de chacun. L’inclusion, loin d’un mot figé sur le papier, se pratique concrètement dans la classe. Les AESH restent le socle discret mais solide de l’école inclusive. Selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale, le nombre d’élèves accompagnés ne cesse de croître. Cette dynamique interpelle : comment rendre le métier attractif, comment fidéliser et permettre à ces acteurs de se former durablement ?
Quelles formations pour devenir AESH et se professionnaliser ?
Le parcours pour devenir AESH offre aujourd’hui plusieurs portes d’entrée. Aucun diplôme spécifique n’est requis, même si le baccalauréat reste une norme de référence. L’expérience auprès de personnes en situation de handicap constitue un véritable atout lors du recrutement. Dès l’embauche, chaque nouvel accompagnant bénéficie d’un socle de formation de 60 heures, organisé par l’Éducation nationale. Ce programme expose la diversité des troubles, les pratiques professionnelles à adopter, et donne les clés pour un dialogue réussi avec les familles.
Le DEAES (diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social) sert de tremplin pour celles et ceux qui cherchent à élargir leurs compétences. Il est possible de le valider par la VAE, reconnaissance de l’expérience acquise sur le terrain, ce qui ouvre la voie à d’autres missions dans le secteur social. Certains candidats s’appuient sur les dispositifs de formation professionnelle portés localement pour renforcer leur parcours en emploi.
Voici les principales composantes de l’offre de formation actuelle :
- 60 heures de formation initiale réparties sur trois ans pour mieux accompagner les débuts
- Accès possible via le DEAES ou la VAE
- Modules complémentaires ajustés selon le profil des élèves suivis
La CFDT Éducation formation et d’autres organisations mettent souvent en avant les disparités selon les territoires. Il n’existe pas de cadre unique, d’où des inégalités notables d’un département à l’autre. Sur le terrain, certains établissements proposent des modules ciblés : autisme, troubles sensoriels, outils de communication alternative… Plus l’expérience et la formation s’articulent, plus se dessinent de nouvelles perspectives de professionnalisation et d’emploi.
Perspectives d’évolution : quelles opportunités après une expérience d’AESH ?
Être AESH ouvre des chemins multiples dans le médico-social ou l’éducation. Avec les années, la connaissance approfondie des handicaps et des pratiques pédagogiques permet d’espérer décrocher un emploi sécurisé, parfois mieux rémunéré que les débuts sous contrat court.
Après six ans de service en CDD, le passage au CDI devient envisageable. Ce tournant reste souvent attendu, même si la rémunération et les primes se révèlent modestes face à d’autres fonctions publiques. Les droits sociaux progressent malgré tout : accès au congé de grave maladie, progression en formation continue, accompagnement vers la VAE pour consolider sa trajectoire.
Nombre d’accompagnants choisissent d’élargir leur parcours professionnel : éducateur spécialisé, poste en structure médico-sociale, ou implication dans la formation de nouveaux collègues. Les structures locales accompagnent ces reconversions, car les besoins ne faiblissent pas. Reste que pour beaucoup, c’est l’engagement pour l’inclusion qui motive durablement, bien au-delà de la salle de classe.
Pourquoi investir dans la formation d’AESH, c’est miser sur l’avenir de l’école inclusive
La formation d’AESH n’est pas une formalité administrative : elle façonne concrètement la qualité d’accompagnement dont bénéficie chaque élève. Au quotidien, l’école inclusive s’appuie sur ces professionnelles et professionnels qui savent adapter leur posture, comprendre la complexité des situations de handicap, établir un véritable partenariat éducatif avec les enseignants. Les récentes avancées législatives et directives du ministère de l’Éducation nationale vont dans ce sens : renforcer la formation, c’est garantir un suivi cohérent et exigeant pour chaque enfant.
Les conférences nationales du handicap l’ont rappelé : tant que la professionnalisation n’est pas réelle, l’inclusion scolaire reste fragile. Les syndicats scolaires, dont CFDT Éducation, Sgen-CFDT et SNES-FSU, appellent d’ailleurs à un projet de formation ambitieux, ancré dans la réalité de terrain. Les pouvoirs publics, eux, optent pour une progression mesurée, un socle commun articulé à des modules thématiques.
Voici les lignes directrices qui structurent ce renforcement :
- Mieux comprendre les troubles cognitifs
- Intégrer les gestes professionnels adaptés
- S’approprier les outils numériques pour soutenir l’accessibilité
Longtemps relégué au rang de métier “transitoire”, le travail des AESH se place aujourd’hui au cœur de la politique éducative. Si la France tient à l’égalité des chances, miser sur ces accompagnements n’a rien d’une option accessoire : c’est le socle invisible grâce auquel, demain, chaque élève pourra enfin avancer, sans justification à donner.